L’Épopée cathare
L'Épopée cathare Michel Roquebert Quatrième(s) de couverture L'invasion 1198-1212 Il y a près de huit siècles, à l'instigation du pape innocent III, le fer et le feu s'abattaient sur les…
L'Épopée cathare Michel Roquebert Quatrième(s) de couverture L'invasion 1198-1212 Il y a près de huit siècles, à l'instigation du pape innocent III, le fer et le feu s'abattaient sur les…
 René Nelli
René NelliNé le 20 février 1906 à Carcassonne et mort le 11 mars 1982 à Carcassonne, inhumé au cimetière de Saint-Vincent dans cette même ville, est un poète occitan, philosophe et historien du catharisme.
Docteur ès lettres, professeur de lettres et de philosophie.
Professeur d’ethnographie méridionale à la faculté des lettres de l’Université de Toulouse.
Poète, essayiste, hermétiste, René Nelli est surtout connu pour ses travaux sur la culture occitane et sur le catharisme.
René Nelli aimait à dire qu’il était descendant d’une famille de sculpteurs florentins installés dans l’Aude au XVIe siècle.
Dans les années 1928-1930, et jusqu’en 1950, René Nelli a été très lié avec le poète Joë Bousquet et a pris à ses côtés une part active à l’élaboration du « surréalisme méditerranéen ».
Il a participé très activement à la revue d’ethnologie méridionale Folklore, fondée par Fernand Cros-Mayrevieille, et a joué un rôle important en ce qui concerne la connaissance de la culture occitane, notamment en participant à la fondation avec Jean Cassou en 1945, à Toulouse, de l’Institut d’études occitanes.
Il fut également le fondateur du Centre d’études cathares en 1981 qui prit son nom un an plus tard, à sa mort.
C’est au contact de Déodat Roché qu’il s’initia au catharisme.
Source : Wikipedia
La vie quotidienne des cathares du Languedoc au XIIIe siècle René Nelli Quatrième de couverture Le catharisme s'inscrit dans le mouvement de rénovation évangélique qui s'est manifesté dans toute la…
 Yves Maris
Yves MarisDocteur en philosophie de l’Université de Toulouse II
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Toulouse
Diplômé du Centre de Perfectionnement aux Affaires du Grand Sud-Ouest
Maire de la Commune de Roquefixade de 1983 à 2009.
Né le 8 mai 1950, Yves Maris, issu d’une famille d’industriels du textile, avait fait sa carrière comme administrateur judiciaire et syndic de sociétés en liquidation.
À son retour du service militaire, il fréquente l’Hestia (la maison) de Fanita de Pierrefeu à Montségur et l’univers aussi étrange que cosmopolite qui y gravitait. C’est là qu’il découvre la pensée des cathares.
Ne se satisfaisant désormais plus de sa voie professionnelle, il l’abandonne pour des études supérieures de philosophie, puis empreint de l’esprit et de la spiritualité cathares, il décide de vivre à leur image dans maison, la Bastida dels cathars.
Cela ne l’empêchera pas de conserver un goût pour la vie publique, puisque élu du village de Roquefixade, il fera même une petite incursion sans lendemain vers les élections législatives. (suite…)
L'Inquisition en Quercy Jean Duvernoy Le registre des pénitences de Pierre Cellan 1241 - 1242 Quatrième de couverture L'inquisiteur Pierre Cellan est venu en Quercy entre 1241 et 1242 et…
Le dossier Montségur Jean Duvernoy Quatrième de couverture Plusieurs chroniques font allusion à la reddition de la forteresse de Montségur et au bûcher qui l'a suivi. Mais l'essentiel de l'histoire…
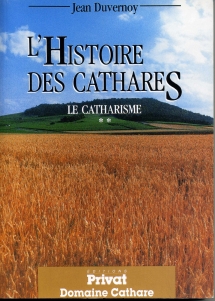 Le catharisme
Le catharismeQuatrième de couverture
Depuis de longues années, le catharisme suscite un vif intérêt tant en France qu’en de nombreux autres pays.
C’est à l’étude approfondie de cet univers religieux et culturel que s’attache Jean Duvernoy.
Avec un esprit de synthèse, il nous présente dans cet ouvrage l’histoire des différentes Eglises qui, de l’Asie Mineure à l’Angleterre en passant par l’Occitanie, ont pendant plusieurs siècles confessé et pratiqué cette religion.
L’étude de Jean Duvernoy se limite à la vie interne de ces communautés en laissant délibérément de côté l’histoire de l’Inquisition, de la répression, des événements diplomatiques et militaires. Ainsi une information minutieuse, appuyée sur l’état le plus récent des recherches historiques permet de suivre l’épanouissement et les épreuves de la foi médiévale dont l’attrait est fortement ressenti par notre époque moderne. (suite…)
La spiritualité du Moyen Âge occidental (VIIIe-XIIe siècles) André Vauchez Quatrième de couverture On a longtemps considéré le Moyen Âge comme l'âge d'or du christianisme. Aujourd'hui en revanche, on assiste…
Le phénomène cathare - René Nelli Quatrième de couverture Dans la pierre qui monte, toujours une avec le rocher que je contemple, s'arc-boutant, transpercés de tous les rayons de la…
Écritures cathares - René Nelli Quatrième de couverture Cet ouvrage avait été voulu, conçu et réalisé par René Nelli dès 1959, dans le but très clairement défini d'offrir au lecteur…