1 042 vues
Journées d’études Internationales «Aux sources du Catharisme»
Le 25 octobre à Carcassonne, pour sa première partie, puis le 27 octobre à Mazamet, pour la seconde, se tiendra un colloque qui s’annonce très important pour le catharisme et pour remettre à leur juste place les éléments permettant d’établir les origines du catharisme.
Présentation
Voici l’annonce faite par la maison des mémoires de Mazamet, co-organisatrice de l’événement :
« Journées d’études Internationales organisées par le CIRCAED (Collectif International de Recherches sur la Catharisme et les Dissidences) en partenariat avec Le Centre des Monuments Nationaux (château comtal de Carcassonne), le Musée du Catharisme de Mazamet, l’Université Radboud de Nimègue et la Région Occitanie .
Le phénomène historique connu sous le nom de « cathare » et aujourd’hui plus volontiers qualifié de « dissidence des Bons Hommes », a de tout temps fait couler beaucoup d’encre ; et toujours dans un climat de controverse et de tension. Au Moyen Âge, la dénonciation et condamnation de l’hérésie — et des hérétiques — par le pouvoir religieux, s’est exprimée dans une littérature de réfutation théologique de caractère polémique ; s’en est suivie une abondante historiographie, de laquelle la recherche actuelle est encore, plus ou moins directement, tributaire. Depuis le milieu du XXe siècle, que l’étude de la dissidence médiévale échappe au monopole presque exclusif de l’historiographie catholique, les travaux qui lui sont consacrés continuent à susciter des réactions très vives ; ainsi, en 1977, de l’ouvrage de Jean Duvernoy, La religion des cathares, qui établissait la nature chrétienne, et non néo-manichéenne, de la dissidence — thèse qui fait aujourd’hui l’unanimité.
La recherche récente dans le domaine n’a fait qu’amplifier ce phénomène. En témoigne l’ouvrage Cathars in Question, Actes du dernier colloque organisé par nos collègues d’York (RU). Les questions sur la nature doctrinale du catharisme, sur ses origines historiques, etc., ont été évacuées, avant même d’être vraiment débattues, par des auteurs réclamant comme préalable une mise en cause de l’existence même de la dissidence au Moyen Âge — que l’hérésie ait été une invention des clercs médiévaux ou même une construction historique du XIXe siècle, due pour l’essentiel à l’œuvre du pasteur strasbourgeois Charles Schmidt (Histoire et doctrine des cathares ou albigeois, 1848).
Les Journées d’études que nous proposons ont pour simple but de mettre les choses à plat. Nous sommes conscients qu’il est temps maintenant, sur un thème historique aussi controversé que le « catharisme », de revenir aux fondamentaux, en honnête confrontation de travaux. L’Histoire s’écrit sur l’étude critique des sources. Aux sources, il faut revenir, à commencer par les sources originales.
En effet, contrairement à certaines affirmations mal informées, le phénomène cathare est amplement documenté, et de manière diversifiée. Dans le double cadre d’une exposition « Aux Sources du catharisme », réalisée par le Service culturel des Monuments Nationaux (château de Carcassonne) et du Musée « Mémoire du catharisme » de Mazamet, nous mettrons ici un accent particulier sur les Sources originales — quatre manuscrits médiévaux très probablement « de main cathare », recueils de littérature religieuse en latin ou en occitan, qui ouvrent un accès direct à la religiosité dissidente — mais sont encore largement sous-utilisés par la recherche. On complètera par un bilan de l’apport des Sources judiciaires de l’Inquisition, qui éclairent, anthropologiquement et socialement, les dissidents eux mêmes ; hommes et femmes, religieux et laïcs, en Languedoc et en Italie.
Les travaux ici présentés sur ces sources n’ont pas tant pour objet d’y rechercher confirmation (ou infirmation) d’anciens topiques historiographiques sur la dissidence, que de poser sur elles un regard ouvert et neuf, propice à de nouveaux questionnements. C’est dans cette perspective, particulièrement ouverte, que les spécialistes internationaux participant à ces Journées d’études, proposeront ainsi le bilan très novateur de leurs recherches et réflexions sur la « dissidence des Bons Hommes ».
Moyens de transport
Carcassonne dispose d’un aéroport desservi par la compagnie Ryan Air. Sinon, vous pouvez venir via l’aéroport de Toulouse-Blagnac où une navette vous déposera à la gare Matabiau qui propose plusieurs trains par jour pour Carcassonne (40 mn à 1 h de trajet). Si vous contactez l’administrateur du site assez tôt, un service de récupération en gare sera possible.
Si vous venez en train, Carcassonne est desservie par la SNCF. Même option de récupération si nécessaire.
En voiture, nous sommes desservis par l’autoroute A61 avec deux sorties (est et ouest selon votre arrivée). La ville est modeste, la traverser ne pose pas de problème.
Pour le transfert Carcassonne-Mazamet, nous allons essayer d’organiser un système de co-voiturage. Contactez l’administrateur.
Programme
Anne Brenon vient de m’adresser le programme de ces journées :
Jeudi 25 octobre 2018 – Château comtal de Carcassonne :
Toutes les infos et réservations des places pour la journée du 25 à Carcassonne sont à prendre au 04 68 11 70 72 ou par courriel.
Président : Jean-Pierre Albert (Directeur de recherche EHESS, Toulouse).
Matin
- Peter Biller (Université d’York, Royaume Uni)
Introduction : « L’état actuel de la recherche sur le catharisme (destruction moderne ?) ».
- David Zbiral (Université Mazaryk, Brno, République tchèque) : « Le manuscrit du Liber de duobus principiis et du Rituel de Florence et ses lecteurs. La genèse d’un livre dissident ».
Après midi
- Daniela Müller (Université Radboud de Nimègue, Pays Bas) : « Le Rituel comme expression d’une foi vivante. Quelques aspects en lien avec le Rituel cathare de Florence ».
- Emmanuel Bain (Université Aix-Marseille, TELEMM) : « Le point sur le manuscrit de Lyon, B.M. A.I. 54 (Palais des arts 36) ».
- Pilar Jiménez (CIRCAED) : « Le supposé dualisme des bons hommes occitans à travers leurs sources. L’exemple du ‘Traité cathare anonyme’ ».
Discussion et débat.
Soirée
Visite commentée de l’exposition « Aux sources du catharisme », réalisée par le Service Culturel du Château de Carcassonne.
Vendredi 26 octobre 2018. Journée de visites et excursions
Matin
Visite du château de Carcassonne
Après-midi
Excursion archéologique, sites de la Montagne Noire – (visites et déplacements non pris en charge).
Soirée
Accueil des intervenants à Mazamet
Samedi 27 octobre. Mazamet (Palais des Congrès)
Toutes les infos et réservations des places pour la journée du 27 à Mazamet sont à prendre au 05 63 61 56 56 ou par courriel.
Matin
- Grado Merlo (Université de Pise, Italie)
Introduction : « L’état de la recherche en domaine hérétique, en particulier pour ce qui concerne les orientations actuelles des études sur les cathares ».
- David Zbiral (Université Mazaryk, Brno, République tchèque) : « L’endura. Relecture des sources ».
Après midi
- Daniela Müller (Université Radboud de Nimègue, Pays Bas) : « Se souvenir au prix de la vie. Les protocoles de l’Inquisition méridionale ».
- Marina Benedetti (Université de Milan, Italie) : « Retour sur l’inquisiteur Pierre de Vérone. Aux sources d’un ‘complot’ et d’une canonisation ».
- Daniel Toti (Université de Milan, Italie) : « Le De heresi catharorum. Réception, érudition et nouvelles pistes de recherche ».
Soirée
- Table ronde sur les « Sources cathares ».
Animée par Dominique Iogna-Prat (Directeur de recherche, EHESS, Paris)
Discussion avec tous les intervenants aux Journées.
Comme vous le voyez, les «sources» qui seront évoquées ne sont pas les sources historiques mais les sources bibliographiques cathares, c’est-à-dire celles écrites de leurs mains. En effet, les forces négationnistes qui veulent aujourd’hui nier jusqu’à l’existence des cathares font, bien entendu, l’impasse sur ces sources qui les gênent.
Il en est d’ailleurs une autre dont David Zbiral s’était employé à prouver l’authenticité : la charte de Ninquinta.
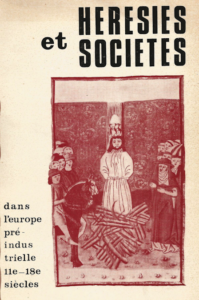 Hérésies et sociétés
Hérésies et sociétés
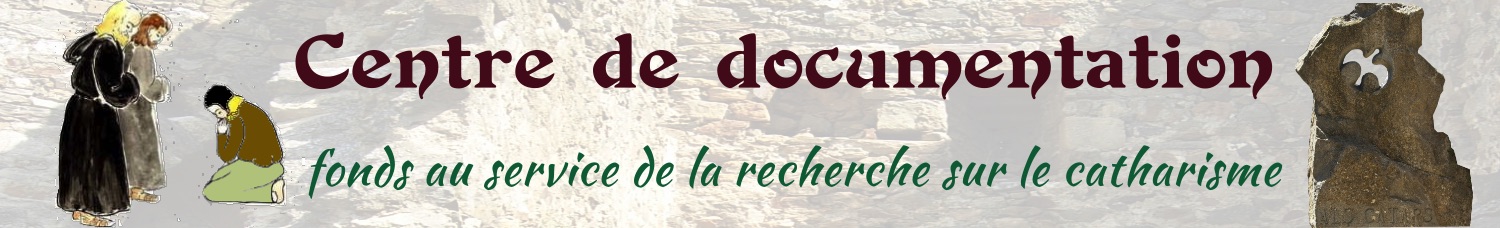

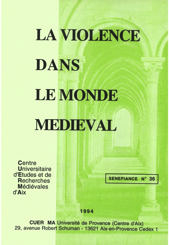 La violence dans le monde médiéval
La violence dans le monde médiéval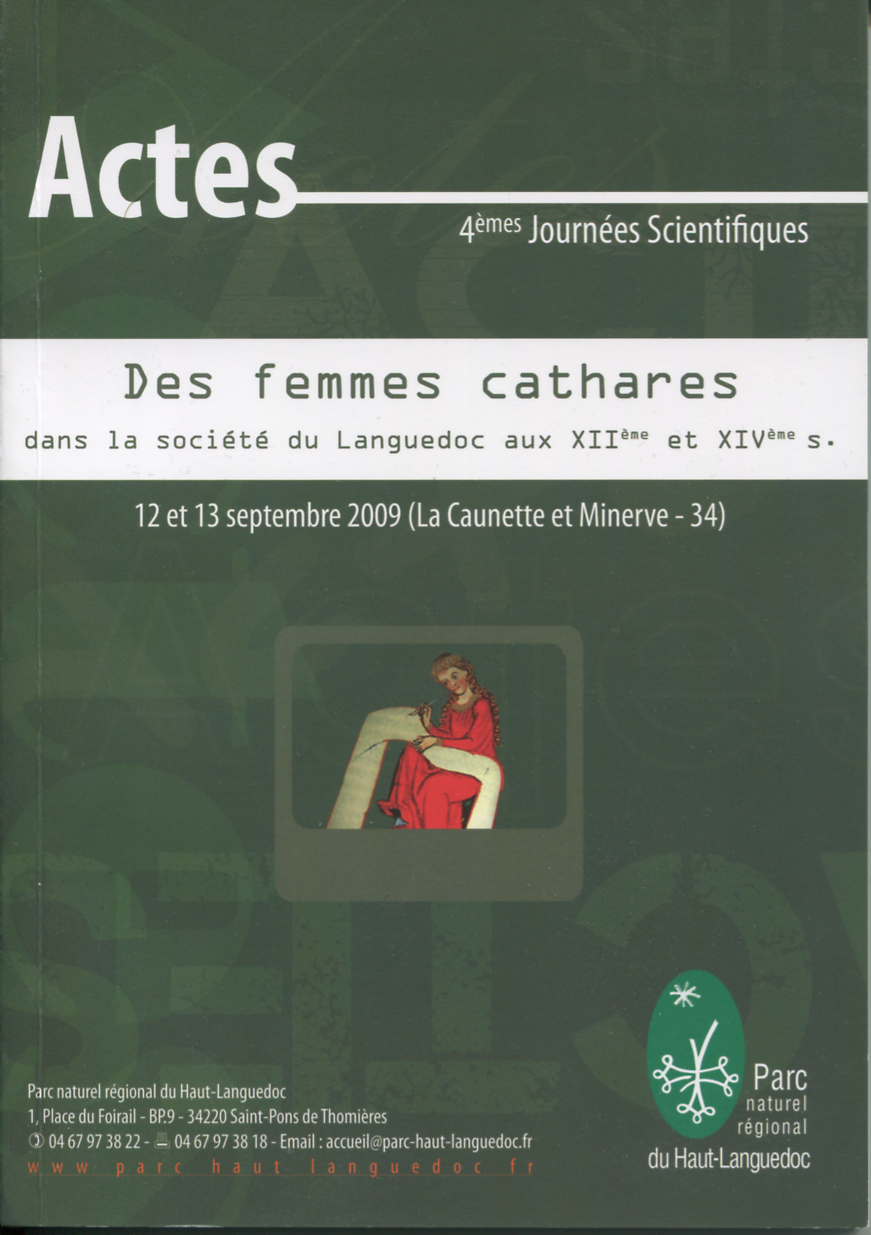 Des femmes cathares dans la société du Languedoc aux XIIIe et XIVe siècles
Des femmes cathares dans la société du Languedoc aux XIIIe et XIVe siècles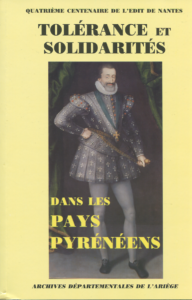
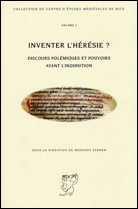 Inventer l’hérésie ?
Inventer l’hérésie ? Traité contre les bogomiles de Cosmas, le prêtre
Traité contre les bogomiles de Cosmas, le prêtre