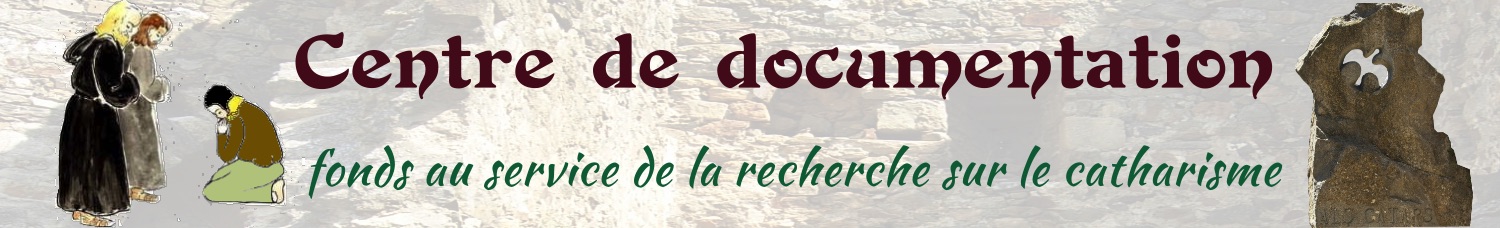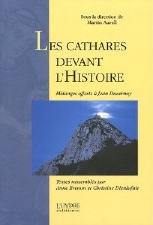1209-2009, cathares, une histoire à pacifier
1209-2009, cathares, une histoire à pacifier
Actes du colloque international tenu à Mazamet les 15, 16 et 17 mai 2009 sous la présidence de Jean-Claude Hélas.
Textes rassemblés par Anne Brenon
Éd. Loubatières, collection Histoire (2010) – ISBN 978-2-86266-629-7.
Quatrième de couverture
Aucun chantier historique n’est jamais clos, puisque l’Histoire s’inscrit elle-même dans l’Histoire, et que chaque génération d’historiens pose au matériau documentaire un questionnement renouvelé. Ainsi du phénomène hérétique médiéval, en particulier de l’histoire des groupes dissidents aujourd’hui conventionnellement désignés comme « cathares ».
Depuis Jean Duvernoy, nous savons désormais que les cathares étaient des chrétiens médiévaux, représentatifs du débat intellectuel et spirituel du tournant des XIIe et XIIIe siècles, et selon des développements sociaux divers, bien au-delà des seuls pays d’oc.
En mai 2009, à Mazamet, un colloque international a permis à une vingtaine de spécialistes de toutes disciplines – de l’histoire médiévale à celle des religions ou à la philologie romane – d’exposer et de confronter, en amical et respectueux débat, les avancées de leur recherche sur les « cathares ». Les communications s’organisaient selon trois grands thèmes : la construction de l’hérésie ; théologie et ecclésiologie de la dissidence ; causes et conditions de la disparition du catharisme ; chaque partie étant suivie d’une table ronde entre les chercheurs et avec le public.
Tel est l’ensemble qui se trouve ici retranscrit.
Images et concepts de « l’hérésie », 800 ans après la croisade contre les Albigeois, ressortent aujourd’hui précisés, clarifiés – tendent enfin à s’exorciser. Et on se prend à respirer le grand bol d’oxygène d’une recherche neuve, rajeunie.
Ce que j’en pense
Les habitués du site avaient déjà eu mon appréciation de ce colloque qui m’avait ravi par le fait qu’il se décidait enfin à aborder l’aspect théologique du catharisme qui fait si souvent défaut aux travaux historiques.
Autant dire que ces actes sont à mes yeux indispensables à ceux qui n’ont pu y assister et tout autant à ceux qui y participèrent et souhaiter en étudier les communications d’une qualité indéniable.
Merci à tous les intervenants, à ceux qui ont permis cette rencontre et à ceux qui nous permettent de détenir ce document.
Vivement un prochain colloque aussi bien fourni avec, pourquoi pas, l’étude du pré-catharisme du IIe au Xe siècle.
Voici ci-dessous le sommaire de ce document avec les photos des participants :
Le colloque est présidé par M. J.-C. Hélas (Maître de conférences honoraire à l’Université P. Valéry – Monpellier III).
La construction de l’hérésie
Pilar Jiménez, chercheur associé CNRS-UMR 5136 Framespa, université Toulouse 2 Le Mirail.
Retour sur la construction historiographique des origines orientales du catharisme
David Zbiral, Docteur en histoire, université Masaryk de Brno
La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix, État de la question
Édition critique de la charte de Niquinta selon les trois versions connues
Travis Stevens, Harvard Divinity School.
Innocent III et la rhétorique contre l’hérésie
Marjolaine Raguin, doctorante en langue et littérature médiévale occitane à l’université Paul Valéry – Montpellier III.
Hérésie et hérétiques dans la Chanson de Guilhem de Tudèla
Carlos Gascon Chopo, doctorant en histoire médiévale. UNED Madrid.
Sur les cathares en val d’Aran
Franco Morenzoni, Professeur d’histoire médiévale, université de Genève.
Hérésies et hérétiques dans la prédication parisienne de la première moitié du XIIIe siècle
Thomas Butler, ancien professeur de langues et littératures slaves, universités du Wisconsin et Harvard.
Les « chrétiens » bosniaques : origines, croyances et influence socio-politique du XIIIe au XVe siècle.
Table-ronde animée par Guy Lobrichon
Théologie, ecclésiologie et sociologie
Daniela Müller, Professeur d’histoire de l’église, université de Nimègue.
Les historiens et la question de vérité historique. L’Église cathare a-t-elle existé ?
Lidia Denkova, professeur département de philosophie et sociologie, nouvelle université bulgare de Sofia.
Origine et originalité de l’hérésie, « retrocendum ad principia magis communia »
Francesco Zambon, Professeur de philologie romane à l’université de Trente.
L’interprétation cathare des paraboles évangéliques : les deux arbres, la brebis et la drachme perdues.
Nataliya Dulnyeva, docteur en histoire, université de Lvìv et Andrèi Pechenkine, département d’études religieuses, université de Tula.
Les fondements de la lecture cathare du prologue de l’Évangile de Jean.
Ylva Hagman, Docteur en histoire des religions, université de Linköping (Suède).
« La Brevis Summula contre herrores notatos heretichorum » et le point de vue des églises cathares.
Roland Poupin, docteur en théologie et philosophie. Pasteur de l’église réformée de France à Antibes.
À propos des tuniques d’oubli.
Table-ronde animée par Daniela Müller
Causes et conditions de la disparition du catharisme
Claudine Pailhès, Archiviste paléographe, conservateur en chef des archives de France-AD 09
Les comtes de Foix face à l’hérésie
Gwendoline Hancke, docteur en histoire. Université de Poitiers.
Le faydit, l’épouse et la concubine : le destin ordinaire de la famille de Mazerolles entre hérésie, croisade et Inquisition.
Jean Duvernoy, historien.
Jordan de Saissac
Anne Brenon, Archiviste paléographe, conservateur en chef honoraire des archives de France
Les années 1230-1245 : premiers jalons d’une déprise du catharisme en pays d’oc ? Exemple de deux seigneuries de la Montagne Noire.
Annie Cazenave, Ingénieur (CNRS).
« Genus heretichorum« .
Table ronde finale sous la direction de Julien Roche, Archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques, université de Lille I.